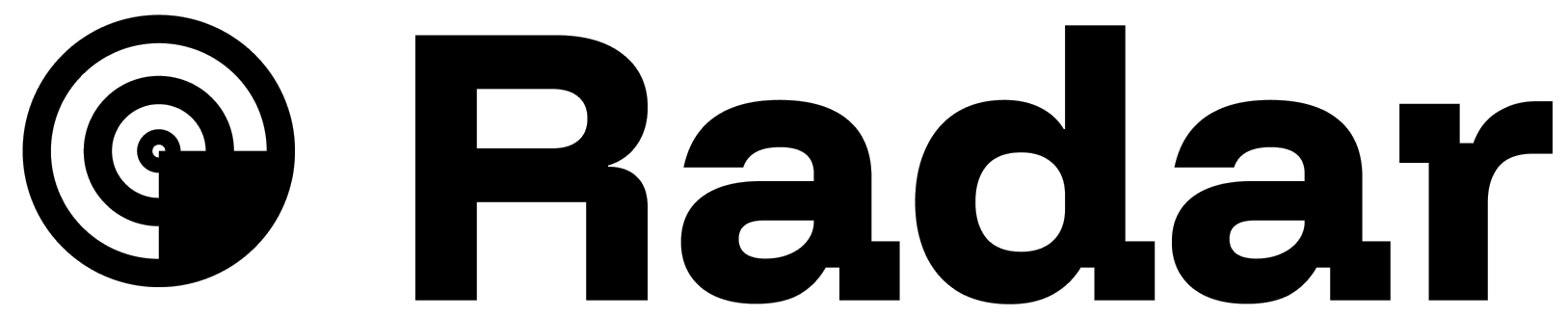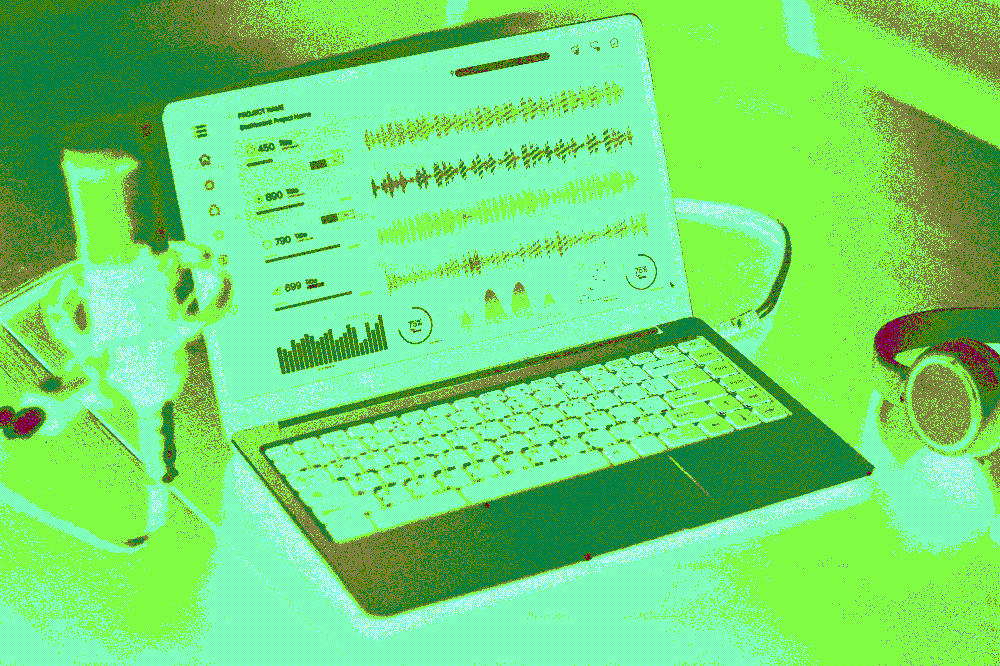Depuis ses débuts, Deezer cherche à se distinguer de la concurrence en rémunérant plus justement ses artistes. Là où la plupart des plateformes, notamment Spotify, fonctionnent au « pro-rata » – c’est-à-dire que les revenus des écoutes totales sont reversés aux artistes les plus streamés – Deezer, lui, fonctionnait jusqu’à présent sur un modèle dit « user-centric ».
Un mode de rémunération reposant sur une logique simple : chaque abonné rémunère uniquement les artistes qu’il écoute réellement. Par exemple, si un utilisateur passe 80 % de son temps d’écoute sur Pomme et 20 % sur The Weeknd, les revenus générés par son abonnement seront répartis dans ces proportions entre ces deux artistes.
Mais d’importants problèmes rendaient ce modèle de moins en moins viable. En effet, il était possible de biaiser la répartition des revenus avec des bots – ces programmes dont la seule fonction est d’écouter un morceau en boucle.
Autre souci : les tracks dits de « bruits » (ambiance sonore, pluie, …) ainsi que les récents morceaux générés par intelligence artificielle polluant le catalogue tout en se voyant attribuer des revenus indus.
C’est donc dans un communiqué publié le 15 janvier conjointement avec la SACEM, que Deezer annonçait remplacer le « user-centric ». “Il s’agit de la première évolution majeure depuis l’avènement du streaming, il y a plus de 15 ans.” Une promesse de taille.
L’« artist-centric » – c’est son nom – n’est en réalité pas vraiment une “évolution majeure”, mais plutôt une sorte de voie médiane entre le pro-rata et le user-centric. Visant à favoriser une redistribution plus juste des revenus issus des abonnements, il repose sur deux grands principes.
Premièrement, un plafond pour limiter l’influence qu’un utilisateur peut avoir sur le partage des royalties. Au bout d’un certain nombre d’écoutes d’un seul morceau par un seul utilisateur, la plateforme cesse de générer des revenus. Une garantie pour que l’argent versé par les abonnés revienne réellement aux artistes qu’ils écoutent, tout en réduisant les risques de comportements frauduleux.
Deuxièmement, Deezer double la rémunération par stream pour les artistes qui prouvent un « engagement réel » : ceux dont les morceaux atteignent au moins 1 000 écoutes mensuelles provenant de 500 abonnés différents. Ce bonus s’applique également aux chansons activement recherchées ou présentes dans des playlists sélectionnées manuellement, hors algorithmes.
Deezer et la SACEM défendent ce nouveau modèle de rémunération, en affirmant contribuer à une « économie musicale durable ». Encore faut-il les croire sur parole.
« On est un des seuls business au monde qui ne rémunère ni le producteur, ni l’artiste derrière. »
« Dès qu’on a compris que ça allait démonétiser des centaines de milliers de titres, on s’est dit que ce n’était pas juste. » Pour Mathieu Dassieu, président de la Fédération Nationale des Labels et Distributeurs Indépendants (FELIN), le « artist-centric » est une régression.
Avec le « artist-centric » en effet, les titres en dessous de 1000 écoutes par an ne sont plus éligibles aux royalties (contre 500 auparavant). Une grille qui l’aligne sur le reste des plateformes de streaming, Spotify en tête.
Ce sont donc plusieurs milliers d’artistes qui, faute d’écoutes, sont mis dans le même panier que les morceaux de bruits ou générés par IA, et ne touchent plus rien sur leurs titres pourtant écoutés.
C’est ce que soulignait déjà une étude menée par le laboratoire Analyse des Crises et Transitions, rattaché à l’Université Sorbonne Paris Nord. Parue en 2024, celle-ci compare les deux modes “user-centric” et « artist-entric » au classique modèle du « pro-rata ».
On voit en effet clairement que, là où pour le modèle « user-centric », les artistes en dessous de 1000 écoutes par an perdent environ 8% de leur revenu comparé au pro-rata, avec le « artist-centric », ce nombre s’élèvent à 20%.
Le président de la FELIN tranche : « On est un des seuls business au monde qui ne rémunère ni le producteur, ni l’artiste derrière. Pourtant, les titres sont quand même consommés. »
La musique, les artistes en moins
Les artistes sont bien sûr les premiers impactés ces choix ; ils sont contraints de se plier aux algorithmes.
Les plateformes négocient exclusivement avec les majors ou certains gros producteurs indépendants. Pour pouvoir enregistrer, et ensuite être publiés, les artistes sont en effets obligés de céder leurs droits aux labels ; ils n’ont ni visibilité ni levier sur les accords passés.
« Le mode de fonctionnement du streaming a été développé par des innovateurs de la tech, avec le soutien de l’industrie du disque qui en avait absolument besoin. Et ça a été pensé sans rémunérer toutes les parties prenantes de la filière musicale. »
Thomas Dayan, secrétaire général adjoint de la FIM
Pour Philippe Gautier, représentant du syndicat SNAM-CGT, l’Union Nationale des syndicats des musicien.nes, premier syndicat d’artistes français, la situation du streaming n’est pas pensée avec les artistes en tête. Il tranche : la promesse de plateformes qui prétendent rémunérer directement les artistes relève du mensonge.
Ainsi, si déjà les morceaux des petits artistes génèrent peu d’argent, il ne reste presque rien après déduction des ayants-droits.
C’est ce que confirme, Thomas Dayan, secrétaire général adjoint de la FIM, la Fédération Internationale des Musiciens, la fédération mondiale représentant les syndicats et organisations professionnelles des musiciens.
Il explique que dès ses origines, le streaming « a été développé par des innovateurs de la tech, avec le soutien de l’industrie du disque qui en avait absolument besoin. Et ça a été pensé sans rémunérer toutes les parties prenantes de la filière musicale. »
Une industrie pensée non pas pour les artistes, mais pour les géants : les majors.

La toute-puissance des majors
Les majors, ce sont les immenses maisons de disque qui possèdent près des trois quarts du catalogue musical, c’est-à-dire des titres écoutables. Elles sont au nombre de trois : Sony, Warner, et la plus grosse, Universal. Ces maisons de disques sont donc incontournables, et font pression sur tout le reste de l’industrie musicale pour obtenir des conditions qui leurs sont favorables.
En France, le SNEP, le Syndicat National de l’édition phonographique, est le relais direct des intérêts de ces majors. Le vice-président de son conseil syndical, Olivier Nusse, est le PDG d’Universal Music France, tandis que deux de ses membres, Alain Veille et Marie-Anne Robert, sont respectivement PDG de Warner Music et Sony Music.
Une influence telle que les processus de décisions de l’industrie musicale sont opaques, sans consulter aucune des parties, qu’ils soient labels, syndicats ou associations d’artistes. Pour Sophian Fanen, journaliste aux Jours spécialisé dans l’industrie musicale numérique, il est quasi impossible d’agir contre la volonté de ces grandes maisons de disques : « ce sont les poids lourds des décisions. »
Ce sont les majors qui impulsent le mode de rémunération global des artistes, et la façon dont les streams sont comptabilisés et reversés. Avec toujours leurs avantages comme priorité première. Sophian Fanen résume : « Quand Universal dit non, tout le monde dit non, quand il dit oui, tout le monde dit oui. ».
Et justement, en 2023, au moment où Deezer introduit pour la première fois le modèle artist-centric, la FELIN publiait un communiqué pointant du doigt « un accord bilatéral entre Universal et Deezer ».
Il est ainsi peu surprenant de constater que les majors sont plus avantagées avec l’artist-centric que l’user-centric. Comparé au pro-rata, les majors voient leurs revenus augmenter de 1,2% par morceau avec le artist-centric, là où ce chiffre est de 0,8% pour le user-centric. A l’inverse, là où les majors perdaient 2,2% de revenus par morceau avec le user-centric, ce nombre chute à 3,1% avec le artist-centric.
Quelques alternatives
Les rares plateformes qui peuvent se permettre de proposer des modes de rémunérations alternatifs, plus justes envers les artistes, sont précisément celles qui contournent les catalogues des majors.
Soundcloud – une plateforme prisée des DJs pour sa tolérance envers les remixes et contenus non officiels, interdits ailleurs – propose un système hybride. Elle combine un modèle pro-rata classique, similaire à celui de Spotify, avec ce qu’elle appelle une rémunération « Fan Powered » – en réalité un système « user-centric » – où l’abonnement d’un utilisateur est réparti uniquement entre les artistes qu’il écoute. Interrogée, le porte-parole de l’entreprise explique que cette double approche permets de mieux équilibrer les revenus, chaque méthode compensant les biais de l’autre.
Bandcamp, une autre plateforme prisée des petits artistes pour les mêmes raisons que Spotify, s’apparente davantage à un disquaire numérique. Après quelques écoutes gratuites, l’utilisateur doit acheter les morceaux pour y accéder durablement. Le prix est fixé par l’artiste ou son label, offrant ainsi un contrôle direct sur la valeur attribuée à chaque œuvre. Et surtout, il n’y a pas d’algorithme qui recommande des titres ; c’est à l’utilisateur lui-même de naviguer pour découvrir de nouveaux artistes.
Un système qui a parfois valu à la plateforme le qualificatif «d’anti-Spotify ». Si, elle ne peut bien sûr par concurrencer le géant suédois en terme de taille, le fait est que Bandcamp est une réelle opportunité pour les artistes émergeants de se faire découvrir, et de voir leurs travaux rémunérer à leurs justes valeurs.
Outre ces plateformes « alternatives », les sommes versées pour un stream peut varier sur les plateformes dominantes. Ainsi, Deezer aussi bien que Spotify divisent ses utilisateurs entre premium et gratuit, le premier rapportant plus à l’artiste que le second.
Une rémunération forfaitaire ?
De multiples formes de rémunération rendent opaque la question centrale de la rémunération des artistes : « Combien vaut un stream ? ».
Pour François Moreau, enseignant-chercheur en économie à l’Université Paris-Sorbonne, et co-auteur de l’étude sur l’artist-centric, la réponse est claire : « cette idée de revenu par stream n’a aucun sens ».
En réalité, tout dépend du « poids » de l’utilisateur. Pour celui qui écoute rarement de la musique, chacun de ses streams va peser lourd dans l’allocation de son abonnement, tandis qu’un auditeur frénétique dilue cette valeur dans des milliers de morceaux.
Le genre de musique lui-même influe sur la valeur d’un titre. Avec le user-centric, le rap perd sa place de tête au profit d’autres genre comme le classique ou le jazz, là où le artist-centric poursuit cette même dynamique en l’aténuant.
Le stream n’a donc pas de valeur fixe : une incertitude et une opacité de plus qui contribue à la précarisation des artistes.
« Cette idée de revenu par stream n’a aucun sens«
François Moreau, enseignant-chercheur en économie à l’Université Paris-Sorbonne
C’est précisément à rebours d’une rémunération fondée sur le stream, nécessairement injuste et soumise à la logique du marché, la SNAM-CGT défend un changement de paradigme complet : la rémunération sur la base de l’abonnement lui-même.
Puisque les utilisateurs paient pour accéder à l’ensemble du catalogue, alors chaque œuvre disponible participe à la valeur globale du service. Dès lors, une rémunération forfaitaire pour la mise en ligne, couplée à une rémunération proportionnelle à l’écoute, serait plus juste.
Le artist-centric ne répond pas à sa promesse
L’artist-centric, malgré son nom, ne remplit pas ses objectifs initiaux. En réalité, il s’agit un retour en arrière, un réalignement sur la rémunération au pro-rata, que Deezer voulait justement éviter avec le novateur « user-centric » de ses débuts. Loin de soutenir les artistes, en particulier les plus petits, elle renforce le pouvoir des majors, au détriment également des labels indépendants.
Un accord qui interroge d’autant qu’en 2011, Universal Music avait porté plainte contre Deezer. Ce dernier avait en effet refusé les nouvelles conditions d’écoutes imposées par Universal, qui essayait de faire barrage au user-centric, moins avantageux pour la major.
Contactés, ni la SNEP, la SACEM et Deezer ne nous ont répondus.
Bastien Laurent