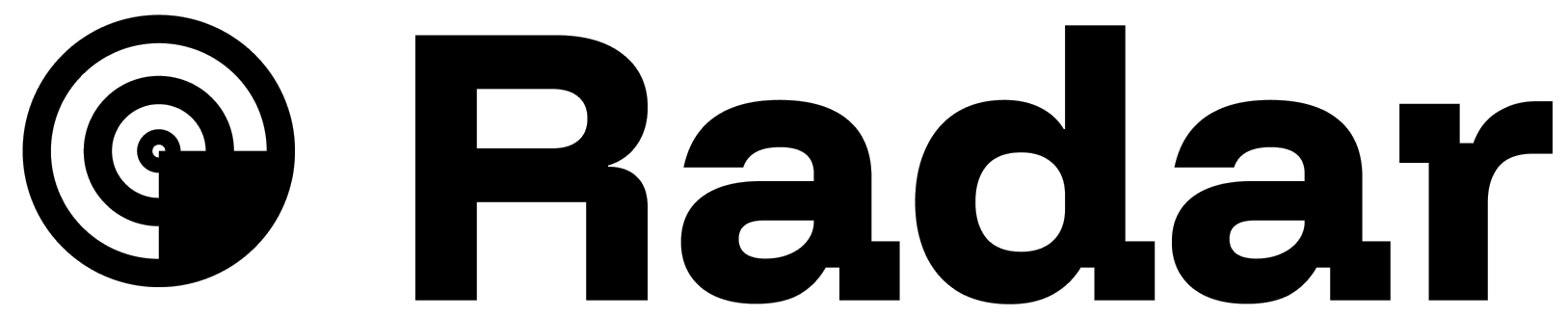Chaque été, le même enfer recommence : le thermomètre s’affole dans les musées Gustave Moreau et Jean-Jacques Henner situés dans les IXe et XVIIe arrondissements de Paris. « La température peut monter jusqu’à 34-35°C à l’intérieur du musée lorsqu’il fait 30°C dehors. Des visiteurs et des agents font des malaises ou sont pris de vomissements », décrit un agent du musée qui souhaite rester anonyme. Les œuvres elles aussi souffrent, comme « les figures de cire de Gustave Moreau, utilisées comme modèles 3D pour ses peintures, qui se sont dégradées à cause de la chaleur ».
Alors que les vagues de chaleur se multiplient à Paris d’après le ministère de la Transition écologique, le personnel de ces musées a lancé une grève en octobre 2024 pour dénoncer les conditions de travail intenables. Depuis huit mois, les grévistes demandent une adaptation urgente des bâtiments pour faire face aux dérèglements climatiques. Actuellement, aucun système de ventilation n’existe dans ces deux musées. « La toiture du musée Gustave Moreau n’est pas du tout isolée » , souligne aussi l’agent.

Seule possibilité pour rafraîchir les salles : ouvrir les fenêtres, à condition que la différence de température avec l’extérieur soit inférieure à 5°C pour ne pas risquer d’endommager les œuvres. Le personnel réclame à minima des solutions transitoires en attendant des travaux d’ampleur d’installation d’une ventilation. « Les agents demandent à pouvoir fermer les salles muséographiques lorsque la température est supérieure à 30°C », déclare Nathalie Ramos, représentante syndicale de la CGT Culture. La direction des musées a été contactée mais n’a pas pu répondre dans les temps.
Les musées n’échappent pas au réchauffement climatique mais peinent à s’y adapter faute de moyens suffisants. Cela a des conséquences graves sur les conditions de travail des employés, le confort des visiteurs, et la conservation des œuvres.
Les musées en alerte climatique
Orsay, l’Orangerie, le quai Branly… Tous ces grands musées à proximité immédiate de la Seine sont directement exposés à la menace d’une grave crue. Ce risque est d’autant plus préoccupant que le réchauffement climatique accentue la fréquence et l’intensité des épisodes de pluies extrêmes, comme le mentionne le sixième rapport du GIEC (2023) qui prévoit une aggravation des inondations en France.
« Les musées en bordure de cours d’eau sont plus menacés que les autres par les effets du réchauffement climatique et les phénomènes extrêmes », rappelle Juliette Remy, chef du département de conservation préventive au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF). Parmi eux, on trouve le musée français le plus célèbre : le Louvre avec ses 8,9 millions de visiteurs annuels.
En 2016, la Seine a atteint un niveau critique, forçant le musée à fermer ses portes afin d’évacuer les œuvres conservées dans les sous-sols. Depuis, le Louvre a fait construire un centre de conservation dans les Hauts-de-France afin de stocker les œuvres auparavant entreposées en zone inondable. « Les matériaux n’apprécient pas l’humidité. Il peut y avoir des réactions en cascade, avec l’apparition rapide de moisissures », précise Juliette Remy.
La présidente du Louvre, Laurence des Cars, déplorait également dans une note adressée à la ministre de la Culture en janvier des infiltrations d’eau entraînant la fermeture de salles, un effet de serre créé par la Pyramide mais aussi « d’inquiétantes variations de température mettant en danger l’état de conservation des œuvres »… autant de signes d’un bâtiment vieillissant confronté au changement climatique.
« En Ile-de-France, nous avons pu observer des phénomènes extrêmes à l’automne dernier comme des inondations qui ont affecté le musée de la Maison Elsa Triolet-Aragon et le musée des Capucins. Dans le premier, de nombreux livres ont été endommagés par l’eau. Et au musée des Capucins, les agents ne pouvaient même plus entrer dans le bâtiment », raconte Juliette Remy.
« Un climat sec peut créer des fissures et abîmer les œuvres », poursuit la conservatrice. Des températures plus élevées « causent des détériorations sur certains matériaux comme le plastique, les papiers acides souvent utilisés pour les archives », estime quant à elle Fiona Graham, restauratrice spécialisée en conservation préventive. L’augmentation de la quantité de pluie peut causer un taux d’humidité trop élevé, lui-même responsable du développement de moisissures, dangereuses pour les objets comme pour les humains.

« La fréquence et l’ampleur du développement de moisissures ou d’infestations augmentent ces dernières années. Il y a des insectes que l’on trouvait seulement au Sud qui apparaissent plus au Nord. Ils préfèrent des conditions plus chaudes et plus humides », ajoute la restauratrice. En janvier dernier, le musée des Beaux-Arts de Brest a retardé sa réouverture de plusieurs années, suite à la découverte de moisissures sur certains tableaux. Il avait déjà été contaminé en 2019 et le changement climatique pourrait être un possible facteur aggravant pour sa directrice Sophie Lessard.
L’absence de stratégie ambitieuse
D’après Laurence Perillat, co-fondatrice du collectif Les Augures qui accompagne les organisations dans leur transformation écologique, les musées devraient dès aujourd’hui analyser leur résilience. Quels aléas risquent de les toucher ? Comment vont-ils pouvoir s’y préparer ? « Ils doivent se demander combien de temps ils peuvent tenir sans Internet, sans électricité, sans l’aéroport le plus proche, sans la route principale. Et ce, afin de préserver les collections, l’activité du musée, le travail des équipes et l’accueil du public. »
Juliette Remy souligne de son côté l’importance de la préparation en cas de phénomène naturel extrême : « Les musées doivent anticiper ces risques en se dotant d’un plan de sauvegarde des biens culturels, un dispositif qui vise à protéger les œuvres en cas de catastrophe ». Pourtant, en 2018, seuls 17 % des musées français en étaient équipés, selon le C2RMF et le ministère de la Culture. Face à ce constat, le C2RMF a mis en place un accompagnement pour aider les institutions à élaborer ces plans.

Mais selon Laurence Perillat, l’adaptation aux aléas climatiques n’est toujours pas une priorité pour les musées. Elle regrette qu’« ils prennent parfois des mesures liées au climat actuel, sans réellement anticiper les conditions futures ».
Elle observe également que l’accumulation de phénomènes climatiques graves – la canicule de 2019, les records de chaleur, les inondations dans le Pas-de-Calais ou à Valence en Espagne, les mégafeux à Los Angeles – deviennent une nouvelle normalité. « Il faut parfois être directement touché, voir ses œuvres détruites ou son musée impacté, pour réagir », conclut-elle avec amertume.
Une résilience au rabais
« S’ils sont généralement de bonne volonté pour s’adapter au réchauffement climatique, les musées n’ont pas toujours les moyens de le faire », constate Juliette Remy. Faire de la transition énergétique un axe de travail prioritaire représente un défi financier majeur. Pris en étau entre la loi Elan de 2018, qui impose des objectifs de sobriété énergétique, et les injonctions à réduire leurs dépenses, les musées doivent composer avec des injonctions contradictoires. D’autant plus que leurs bâtiments, souvent anciens, vastes et mal isolés, sont extrêmement coûteux à entretenir. « Lorsqu’il y a des rénovations à entreprendre, les travaux sont colossaux et très chers », résume Marie Ballarini, chercheuse en management des organisations culturelles.
Ces investissements nécessaires s’inscrivent dans un contexte de finances publiques de plus en plus contraintes. La présidente du Louvre a même récemment réclamé un soutien exceptionnel de 100 millions d’euros pour des travaux de restauration. « Les musées ne vont pas pouvoir assurer les réhabilitations nécessaires avec leur budget de fonctionnement », prévient Laurence Perillat. Un rapport de l’Union européenne de 2022 note qu’aucun chiffrage précis n’existe encore sur le coût du dérèglement climatique pour le patrimoine culturel, mais pour Fiona Graham le constat est clair : « les coûts de fonctionnement des musées risquent d’augmenter en raison du dérèglement climatique. »
Pourtant, les moyens publics diminuent alors même que les enjeux augmentent. « On constate une érosion progressive des subventions de l’État aux musées nationaux », notait déjà en 2019 Brigitte Kuster, ex-députée Les Républicains. Entre 2014 et 2024, les subventions du Louvre ont baissé de 102 à 96 millions d’euros, selon mon étude statistique, pendant que le prix du billet d’entrée grimpait de 83%. « Faute de plus de moyens, les musées et le ministère de la Culture sont obligés de financer les projets par ordre d’urgence », analyse Jean-Michel Tobelem, docteur en sciences de gestion spécialiste des institutions culturelles. Pour Fiona Graham, trois options apparaissent alors pour les musées : « Ne rien faire, augmenter leur budget, ou faire des économies sur d’autres missions ».
Les prémices d’un changement ?
Le ministère de la Culture soutient différents programmes de transition écologique destinés aux musées, comme le projet « Prenons le contrôle du climat » depuis 2024 en partenariat avec le conseil international des musées en France. Il ambitionne de faire évoluer les musées vers un climat moins gourmand en énergie et donc moins coûteux, tout en respectant les conditions de conservation des œuvres. « Il faut s’adapter aux conditions géographiques, aux moyens techniques, et aux réactions des œuvres de chaque musée. Il n’existe pas de solution unique », résume Fiona Graham. Depuis 2024, dix musées français, sur les 1219 reconnus par le ministère de la Culture, bénéficient du dispositif avec un accompagnement dispensé par des professionnels. Un rapport à destination des autres musées sera produit a posteriori.

Le musée d’histoire de Nantes, logé dans le château des ducs de Bretagne, prend part au programme depuis le mois d’octobre. Comme les autres participants, il mène des expérimentations sur le climat ambiant de certaines œuvres, afin de s’affranchir du modèle très énergivore qui impose une température constante de 20°C et un taux d’humidité strict. Des capteurs ont été installés pour suivre les variations et observer le comportement des œuvres dans des conditions climatiques assouplies. « Cela faisait longtemps que nous envisagions ces expérimentations, mais l’achat de capteurs n’était pas prévu dans notre budget. Ce programme nous a permis de le faire ! », se réjouit Gaëlle Corbin, chargée de la régie des œuvres à Nantes.
Certains musées nationaux ont de leur côté débuté des politiques de transition écologique en autonomie, comme le musée d’Orsay, deuxième musée français le plus visité. Il prévoit dès 2025 des travaux d’adaptation au changement climatique du bâtiment, vieux de plus de 100 ans, comme la rénovation de la verrière à l’entrée. Un diagnostic énergétique doit également être réalisé.
Des adaptations ont déjà été prises pour le personnel situé sur le parvis qui peut désormais « s’habiller en blanc plutôt qu’en noir pendant l’été, […] mettre des manches courtes, et […] porter des tenues en coton et non en synthétique », explique Virginie Donzeaud, administratrice générale du musée dans un article de Challenges. Elle résume bien l’ironie de la situation pour les musées ambitieux mais désarmés : « avoir de grandes ambitions, ça signifie aussi multiplier les actions modestes ».
Pénélope Gualchierotti