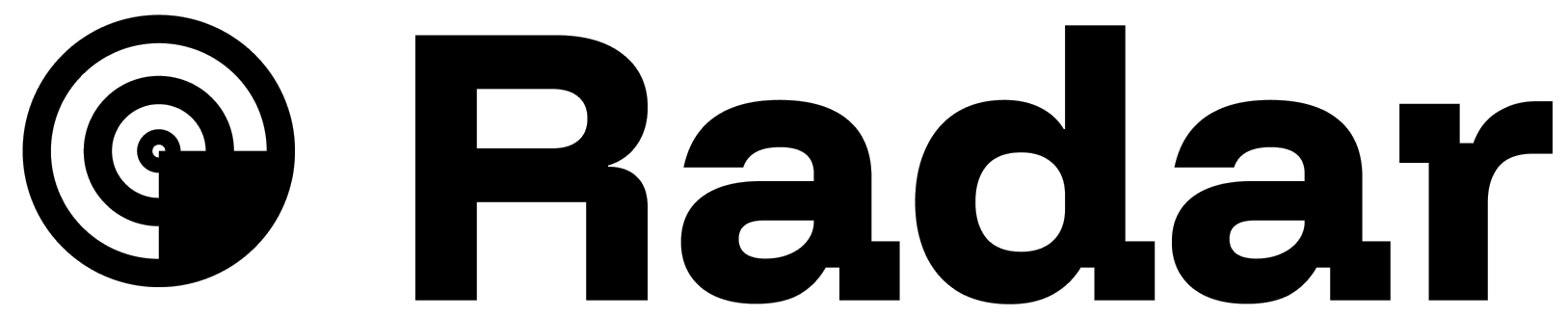32 hectares de champs d’expansion de crues au total seront détruits pour réaliser l’A69. Cette autoroute contestée, de 53 kilomètres entre Toulouse et Castres, menace aussi 22,5 hectares de zones humides. Le concessionnaire qui réalise ce chantier, Atosca, devait commencer les mesures compensatoires dès le début des travaux. En janvier 2025, près d’un an et dix mois après l’arrivée des premiers camions de chantier, certaines zones compensatoires d’expansion de crues n’avaient pas encore été créées. Les juges administratifs se sont appuyés sur cet élément, parmi d’autres, pour motiver leur annulation du projet d’autoroute le 27 février. Avant de faire machine arrière et d’autoriser la relance du chantier à la demande de l’Etat. Les différentes associations ont directement saisi le tribunal de Toulouse, mardi 24 juin.
Depuis 1976, la loi oblige les porteurs de projets à compenser les atteintes portées à la biodiversité par leurs aménagements. Concrètement, ils sont autorisés à détruire, à condition de créer de nouveaux espaces naturels similaires à proximité.
Les mesures compensatoires sont répertoriées dans une base de données renseignée par les agents des Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et des Directions départementales des territoires (et de la mer) (DDT(M)). Ces deux structures sont des administrations déconcentrées de l’Etat chargées des autorisations et du contrôle des mesures compensatoires. On compte près de 8 000 mesures prescrites en France depuis le début des années 2000, et toutes ne sont pas enregistrées.
La destruction des milieux naturels et l’artificialisation des sols sont la « première cause de pression sur les espèces », rappelle Brian Padilla, écologue au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). Les populations d’oiseaux ont décliné de 31 % en France depuis 1989. C’est ce que révèlent les chiffres du MNHN. Un exemple parmi d’autres.
Face à cette érosion spectaculaire du vivant, les mesures compensatoires visent « un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire de gain », selon les termes fixés par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. Cet « objectif n’est clairement pas atteint », explique l’écologue spécialiste du sujet. Dans une étude qu’il a publiée en 2024, le chercheur remet en question la compensation telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui. « La très grande majorité des mesures compensatoires sont réalisées sur des espaces initialement plus riches en biodiversité que le reste du territoire ». Le gain écologique laisse à désirer.
Des mesures parfois mal réalisées
Premier problème : « les mesures compensatoires réalisées sont rarement mises en œuvre comme elles étaient prévues au départ », commence Brian Padilla.
Depuis 2020, les habitants de l’Isle-Adam (Val-d’Oise) peuvent utiliser un port de plaisance dans leur commune. Réalisé par Eiffage, le projet a entraîné la destruction de plus de trois hectares de zone humide. Pour compenser, l’entreprise devait créer et restaurer plusieurs espaces de milieux humides dès le début des travaux en 2016. Mais elle est mise en demeure une première fois le 14 novembre 2017 par la préfecture, car certaines zones de compensation n’avaient pas encore été réalisées. L’entreprise se décide enfin à respecter ses obligations… partiellement. Eiffage est de nouveau mis en demeure le 22 mars 2022 : deux espaces n’étaient toujours pas fonctionnels.
Une attitude négligente et courante selon Benjamin Hogommat, responsable juridique chez France Nature Environnement (FNE) Pays de la Loire. « Il est facile de promettre des mesures compensatoires puis de ne pas les mettre en œuvre », car le processus de contrôle est trop peu dissuasif.
Les suivis : un conflit d’intérêt
Les porteurs de projet ont l’obligation de réaliser le suivi des mesures compensatoires. L’objectif est d’évaluer la bonne mise en œuvre des aménagements et la qualité des résultats produits. Les espèces végétales replantées ont-elles pris ? Les mares sont-elles en eau et habitées par des amphibiens ?
Pour réaliser ces suivis, les porteurs de projet mandatent eux-mêmes des associations ou des bureaux d’études. Autrement dit, les auteurs des suivis sont les clients des entreprises qu’ils contrôlent. « De manière évidente, ils subissent des pressions de la part des porteurs de projet pour ne pas trop faire d’emphase », explique Fanny Guillet, sociologue de l’action publique environnementale au CNRS.
Baptiste Serre, botaniste indépendant, a réalisé son alternance chez Biotope, un des plus gros bureaux d’études environnementales français. Pour lui, le contexte économique concurrentiel peut aussi amener ces entreprises à réduire les tarifs de leurs prestations. Les techniciens ont alors moins de temps pour réaliser des suivis de qualité. « Dans certains cas, le même bureau d’études peut faire à la fois l’inventaire, proposer des mesures, les réaliser, puis faire le suivi », ajoute Diane Sorel, ancienne chargée de communication naturaliste chez Biotope et aujourd’hui conservatrice de la réserve naturelle de la Massane (Occitanie). « Quand c’est toi qui as dit ce qu’il fallait faire, tu es beaucoup plus souple dans ton évaluation des résultats ».
Peu de contrôles de terrain
Les suivis réalisés sont ensuite envoyés aux DREAL et DDT(M) en vue d’un contrôle. Mais ce n’est pas toujours le cas : ils doivent parfois être réclamés par leurs agents, ce qui leur prend plus de temps. « Il arrive que les arrêtés d’autorisation fixent seulement une obligation de mise à disposition des suivis auprès des administrations », et non une obligation de transmission, explique Benjamin Hogommat, de FNE Pays de la Loire.
Si le suivi arrive bien entre les mains du fonctionnaire, encore faut-il qu’il ait le temps de le contrôler. Pour la sociologue Fanny Guillet, on compte environ 80 agents chargés des procédures pour dérogation d’espèces protégées en France. Selon nos estimations, il y a environ 1400 sites de compensation sur cette thématique à contrôler en 2025. Soit dix-huit contrôles par agent. D’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, il faut en moyenne trois jours pour réaliser un contrôle, ce qui équivaut à 54 jours travaillés dédiés à cette seule tâche. Et ce n’est qu’une mission parmi d’autres.
Ce contrôle prend d’abord la forme d’un travail de bureau : vérifier si les suivis transmis par les porteurs de projet révèlent des dysfonctionnements. Si des manquements semblent apparaître, les services instructeurs peuvent lancer un contrôle de terrain, parfois délégué à l’Office français de la biodiversité (OFB). Ces inspections sont peu fréquentes. Elles sont pourtant « indispensables » selon un rapport réalisé sur le sujet par FNE Pays de la Loire en décembre 2016. Ce dernier questionne la « sincérité » des suivis transmis par les entreprises. Les contrôles de terrain permettent de « garantir que les mesures compensatoires sont mises en œuvre et qu’elles sont réalisées selon les modalités définies dans l’acte d’autorisation », précise ce rapport.
Cyrille Cantayre, agent de l’OFB en Normandie, admet ne pas avoir participé à beaucoup de contrôles, car cela ne faisait pas vraiment partie de ses missions. Mais il se souvient de collègues débordés : « ils manquaient de temps, ils étaient peu nombreux et recevaient des dossiers en pagaille pour les prescriptions ». Une situation toujours d’actualité. « Les services de l’État sont sous tension permanente d’instruire des projets nouveaux, pour lesquels ils doivent répondre dans un délai contraint », confirme Brian Padilla.
Interrogé sur le nombre de contrôles, le ministère de la Transition écologique nous a communiqué des chiffres qui ne permettent pas de faire la distinction entre les contrôles de bureau et ceux de terrain. Il précise aussi que ces chiffres ne sont pas « ciblés uniquement sur la compensation ». Ces données établissent 2 617 contrôles en 2024, 520 en 2023 et 540 en 2022.
Les associations, sentinelles des mesures compensatoires
Pour Brian Padilla, les contrôles de terrain sont majoritairement réservés « pour les gros projets qui ont une attention médiatique ou pour lesquels il y a des associations de l’environnement qui sont vigilantes ».
D’après nos recherches en ressources ouvertes, nous n’avons relevé que onze mises en demeure pour des mesures compensatoires depuis 2022. Interrogée sur les suites données aux contrôles défaillants, le ministère de la Transition écologique ne nous a pas répondu. Parmi les onze entreprises mises en garde par les services de l’Etat que nous avons recensées, trois portaient des projets qui captaient particulièrement l’attention des médias. Dans six autres situations, on observait une pression associative.
C’est par exemple le cas du projet de serres chauffées de maraîchage de la société « La Serre des trois moulins » à Commequiers (Vendée), qui a notamment conduit à la destruction de mares et de haies. L’association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale (CTVR) a alerté l’administration sur des manquements au niveau des zones de compensation. Léonard Martineau se souvient avoir observé des bâches plastiques au pied des haies plantées. « Il n’y avait aucune végétation au pied des arbustes et c’est là qu’il y a normalement le plus de biodiversité », développe le président de la CTVR. Il remarque aussi un rejet au niveau du chauffage des serres qui pollue les nouvelles mares : « l’une d’elles était toute noire à un endroit », pointe l’habitant. L’OFB vient contrôler et la société est mise en demeure, sans sanction associée.
De rares sanctions
En cas de mise en demeure par la préfecture, le porteur de projet se voit offrir un délai pour réaliser les mesures compensatoires prescrites. S’il ne les réalise toujours pas dans le temps imparti, il risque une sanction administrative prononcée par le préfet. Selon le Code de l’environnement, elle peut prendre la forme d’une amende, d’une astreinte journalière ou d’une mise en œuvre d’office des mesures à la charge de l’entreprise. « La vérité, c’est qu’il n’y a quasiment jamais de sanctions administratives », extrapole la sociologue Fanny Guillet. « Un maître d’ouvrage a tout intérêt à ne rien faire ».
Seul exemple que nous avons trouvé est celui de lotissements réalisés sur plus de 5 000 m2 de zones humides dans la commune de Biblisheim (Bas-Rhin). Un premier arrêté de mise en demeure est prononcé le 25 juillet 2023 : la Foncière du Rhin est sommée d’acheter sous six mois la parcelle nécessaire pour la réalisation des mesures compensatoires. Ces dernières devaient démarrer avant les travaux du lotissement, terminés en avril 2023. La préfecture donne un an à la Foncière du Rhin pour se mettre en règle. Ce qu’elle ne fait pas. C’est seulement près de deux ans plus tard, le 20 mars 2025, que le préfet prononce la sanction : la société est redevable d’une astreinte de 100 € par jour jusqu’à « satisfaction complète de l’arrêté du 25 juillet 2023 ».
Le recours contentieux comme dernière alternative
Dernière solution pour faire reconnaître des mesures compensatoires défaillantes : le recours contentieux auprès du tribunal administratif par les associations. « S’il y a un risque de recours contentieux, au vu du coût et du temps que cela prend, les porteurs de projet sont prêts à réaliser les mesures compensatoires », considère la chercheuse Fanny Guillet. « Ça fait tenir l’équilibre du système. »
Preuve en est le recours des associations FNE Pays de la Loire et Bretagne Vivante face à la société Serenis. Cette dernière avait réalisé les travaux d’aménagement de la zone commerciale de la Hirtais à Pontchâteau (Loire-Atlantique) sur des zones humides. Mal alimentées en eau, pente trop abrupte… La mise en œuvre des mares de compensation ne permettait pas l’installation d’amphibiens. Les associations ont aussi relevé une mauvaise gestion d’un des bassins, ce qui a conduit à la mort de plusieurs tritons palmés, une espèce protégée. La Cour d’appel de Rennes a tranché en décembre 2023 : elle a donné raison aux deux associations. Même si ces dernières ont salué cette issue, FNE Loire-Atlantique estime dans un communiqué que les sanctions sont « particulièrement faibles » : 1 000 € de dommages et intérêts pour chacune des associations. Une bagatelle pour la société Serenis dont le chiffre d’affaires était de 1,9 million d’euros en 2023.
Agathe Mourey