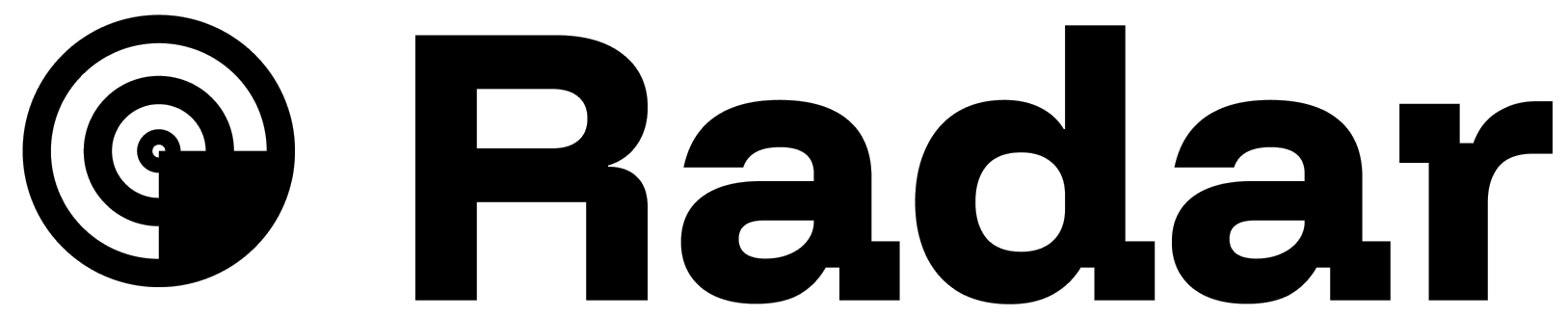Entrer dans la musique aujourd’hui, c’est miser gros dans un marché saturé, où chaque promesse d’ascension peut tourner court. À mesure que le streaming devient la norme, l’écart se creuse : selon le journaliste Mark Mulligan, 1 % des artistes concentrent 90 % des écoutes mondiales¹. Les autres peinent à se faire une place, dans un écosystème dominé par les plateformes et les logiques d’optimisation.
En France, cette fracture est tangible. Le revenu médian des artistes-interprètes atteint tout juste 12 800 euros par an², à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Seul un tiers vit exclusivement de la musique. Pour beaucoup, derrière la passion, c’est un travail à perte.
Mais au-delà des difficultés financières, certains déséquilibres plus profonds apparaissent dès les premiers contrats. Nombre d’artistes, jeunes et peu accompagnés, signent trop vite des engagements contraignants : avances à rembourser, droits cédés, manque d’autonomie.
Il ne s’agit pas ici de dresser un tableau global, ni de condamner l’ensemble des acteurs : nombre de labels agissent en partenaires sincères, des trajectoires positives existent. Mais les témoignages recueillis montrent que certaines pratiques, si elles restent minoritaires, n’en dessinent pas moins un motif récurrent.
Revenus annuels d’un artiste en France en 2024
Lecture : En 2024, 75% des artistes en France ont gagné moins de 10 000€
Tout commence souvent très jeune. Un contact, une main tendue par un label ou un manager, et un contrat présenté comme une chance à ne pas laisser passer — « c’est maintenant ou jamais ». Le parcours du groupe “Renard Tortue” en est l’illustration. Repérés tôt, ils signent « les étoiles dans les yeux » un premier contrat d’édition, sans réelle compréhension des clauses. « On avait un manager qui prenait une marge beaucoup trop importante sur tous nos revenus. Mais on ne s’en est rendu compte que bien plus tard », raconte l’un des membres. L’avocat censé les accompagner ne les avait pas vraiment conseillés — il était en lien direct avec le manager. « On pensait qu’il était là pour nous défendre, mais en réalité, il n’était pas indépendant. » Cette première erreur les enferme dans une relation déséquilibrée. « On était piégés. Il a fallu des années pour s’en sortir, et au final on a préféré tout arrêter. »
Un déséquilibre structurel, selon Maître Dupuy (nom modifié), avocat spécialisé, qui voit défiler des cas similaires dans son cabinet : « La plupart des jeunes artistes ne réalisent pas ce qu’ils signent. Est-ce qu’à 18 ans, on est prêts à aller au casse-pipe ? » À 16 ans, OPAL a elle aussi signé son premier contrat, flattée d’être repérée sur une petite scène. Le manager, bien plus âgé, promet de l’accompagner, mais le décalage est flagrant. « J’avais du mal à faire entendre ma voix. Je n’avais aucune connaissance du milieu ni des codes, et c’est lui qui a raflé la mise ». Dans son entourage d’artistes émergents, « c’est les mêmes galères pour tout le monde » : des carrières compromises avant même d’avoir commencé, par des accords mal négociés, parfois à l’aveugle.
Être viral ou ne pas être
Une signature en label, c’est aussi une avance, une promesse qui cache une réalité est souvent plus brutale. L’argent versé à la signature n’est pas un cadeau, mais bien entendu un prêt à rembourser, souvent dans des conditions opaques. Tant que cette avance n’est pas intégralement recouvrée, l’artiste ne touche rien, ni de la SACEM, ni du streaming. « C’est très simple pour un producteur mal intentionné d’abuser d’un artiste qui ne saisit pas les subtilités contractuelles », explique Maître Kibler, avocat en propriété intellectuelle. L’artiste est censé pouvoir se consacrer à sa musique grâce à cette somme, et faire paraître de nouvelles créations. Les sommes sont parfois dérisoires. Clément (nom modifié), signé pour un an, n’a touché que 2 000 €. « Pas de quoi vivre », nous confie-t-il. Et surtout, pas de quoi créer sereinement. Cette logique transforme l’artiste en débiteur permanent, condamné à courir après le remboursement d’une dette qui, parfois, ne sera jamais soldée. Le rêve d’ascension se mue en précarité consentie, sous le vernis de la réussite : 24 % des compositeurs ont vécu sous le seuil de pauvreté en 2023, et 72 % doivent cumuler plusieurs activités pour survivre³ , le cas de Clément, et de bien d’autres.

Mais la précarité ne s’arrête pas à la signature du contrat. Depuis quelques années, un autre acteur silencieux s’est imposé dans l’équation : l’algorithme. Le streaming et TikTok ont transformé la musique en un marché de la donnée pure, où chaque artiste est réduit à une courbe de vues, de likes, de partages. « Tout repose sur la data : nombre de streams, viralité TikTok, territoires d’écoute… », explique Anton, analyste chez Believe. Les décisions d’investissement, de promotion, voire de maintien sous contrat, se prennent désormais à l’aune de ces indicateurs. Judith Amsallem (directrice créative chez Sony Music France) le reconnaît : « On ne signe jamais un artiste uniquement sur la base de statistiques, mais c’est un complément et une aide. »
Une analyse mathématique, implacable et constante, vécue comme “déshumanisante” par EPAL, chanteuse émergente. « Mes éditeurs ne s’intéressent pas tant à mes morceaux qu’à leur potentiel viral. On me demande de faire des TikToks tous les jours. Je suis censée être artiste mais je dois surtout être influenceuse », s’étonne-t-elle. L’algorithme est devenu le vrai patron, dictant la forme, la durée et le contenu des morceaux. Et pour cause, l’emprise de l’application chinoise sur les résultats des artistes est totale : le taux de conversion d’un engagement TikTok sur un ajout dans une playlist Spotify est en général supérieur à 3 % ⁴. Dans ce contexte, la musique devient un produit parmi d’autres, calibré pour séduire l’algorithme, devenir viral et servir les intérêts d’un label. Les « snippets » (teasing d’un morceau sous la forme de « reel ») de 15 secondes, les refrains pensés pour le scroll, les refrains en boucle : autant de symptômes d’un système où l’artiste, s’il ne veut pas plaire à l’algorithme, risque l’effacement pur et simple. Même les superstars n’y échappent pas : Halsey, forte de 165 millions de disques vendus, s’est vue refuser par son label la sortie d’un single qui lui était cher faute de buzz sur TikTok⁵. Et la star anglaise Charli XCX de publier un meme ironique sur la pression exercée par son label à ce sujet.

« Ce sont les normes du secteur »
Une pression en plus de la part des labels ou des managers, dont le diktat peut aussi s’exercer aussi par des mécanismes contractuels plus subtils que ceux mentionnés plus haut. Les clauses d’option, par exemple, permettent à un label de prolonger un contrat unilatéralement, sans renégociation. Un artiste signe pour un album, mais se retrouve engagé pour cinq à force d’option. Et même si le label décide de ne pas sortir la suite des albums par manque d’intérêt, il garde les droits — bloquant ainsi toute possibilité pour l’artiste de signer ailleurs. « C’est une façon pour les labels de garder la main sans prendre de risques », résume Me Kibler. « L’effet pervers, c’est que ça peut plonger l’artiste dans les limbes, sans soutien ni moyen de sortir de musique », précise-t-il. Des cas qui se terminent régulièrement aux prud’hommes, nous assure-t-il. Quant aux artistes qui demandent des aménagements contractuels, ils se heurtent à un mur : « On vous répond que ce sont les normes du secteur. »
Dizaro jeune artiste de techno-house, lui, se souvient avoir reçu un contrat de quatre pages en PDF, à signer sans négociation possible. « À prendre ou à laisser », dit-il. Et même avec un avocat, le rapport de force est inégal. Philippe Gautier, secrétaire général du SNAM-CGT, avec qui nous avons pu échanger, l’assure : « même les professionnels expérimentés ont du mal à décrypter ces contrats. Imaginez des jeunes artistes de 20 ans ».
Ce tableau pourrait sembler désespérant, mais des alternatives existent. En 2024, deux tiers des revenus générés par les artistes français sur Spotify sont allés à des structures ou artistes indépendants — une exception française, quand ce chiffre plafonne à 50 % au niveau mondial —, se félicite Matthieu Dassieu, président de la Félin (Fédération des distributeurs et des labels indépendants), avec qui nous avons pu échanger. Un signe que, loin des majors, certains parviennent à tirer leur épingle du jeu, à condition de s’entourer et de comprendre les enjeux.
Renard Tortue, aujourd’hui libérés de leur contrat, ont retrouvé une forme de liberté : « On avance lentement, mais on ne dépend plus de personne ». Ils composent, produisent, organisent leurs concerts — sans autre pression que la leur. Pour eux, la création a retrouvé du sens. Pour d’autres, la musique reste un rêve sous contrat, suspendu aux conditions d’un marché qui, plus que jamais, confond notoriété et rentabilité.